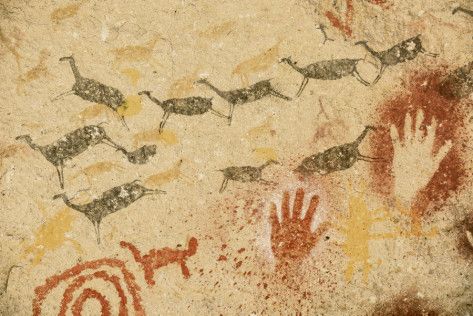A l’approche de la Toussaint si le Parlement européen ne sait plus quoi faire, ne sachant auxquels de tous ces saints il doit se vouer... si Bruxelles se retrouve donc subitement en état de de crise en thèmes, je lui suggère une urgence. Et je m’étonne, dans la foulée de son vote sur l’interdiction du communisme en Europe, que les frères de Juncker n’y aient pas pensé : il faut interdire l’historienne Annie Lacroix-Riz. La brûler (si possible ailleurs que sur la place du Vieux Marché à Rouen, cité bien assez enfumée).
Lacroix-Riz étant récidiviste, le sursis tombe. Avec elle, inutile de prendre des gants ou des pincettes à foyer : au bûcher ! L’historienne qui fait des histoires. De l’Histoire. Naguère cette ennemie de l’intérieur a déjà révélé que, pendant la Seconde guerre la France a produit du Zyclon B. Le gaz qui a alimenté l’extermination dans les camps de la mort. Ecrire qu’en toute connaissance de cause, avec un génocide au bout de la chimie, que d’aucunes de nos élites industrielles tricolores aient pu prêter la main à Eichmann ne relève-t-il pas d’un délit majeur, celui de l’anti-France ? C’est vous dire si Annie Lacroix-Riz est adorée aux péages du capitalisme, sur les autoroutes du pouvoir. Universitaire mondialement reconnue – mais jamais conviée à s’exprimer – Lacroix-Riz tire son savoir, ses révélations fulgurantes, de sa puissance de travail, de son courage. Et du fait qu’elle dorme dans les cartons de salles d’archives, ce qui lui met les cotes en long, donc plus faciles à lire. Quand un imprudent lui oppose un argument boiteux, le malheureux, par exemple, prend sur la tête l’archive 77554 B, une sorte de kalachnikov du savoir, qui prouve tout le contraire de ce vient d’affirmer le hardi expert. La force de Lacroix-Riz c’est qu’elle n’écrit pas, elle tisse. Collés les uns aux autres les documents reprennent vie et font cracher la vérité à l’Histoire. Quand Annie Lacroix-Riz écrit quelque chose, il ne reste à ses contradicteurs qu’à fermer le cercueil à mensonges. C’est dire si cette statue de la Commandeuse est une emmerdeuse.
De son avant-dernier opus, Industriels et banquiers français sous l’occupation (éditions Armand Colin), je retiens une perle qui me plait beaucoup. Qui montre que les hommes nés dirigeants finissent toujours par diriger. Et survivent à tous les crimes afin de faire tourner le monde comme il leur convient. Le Xerox social, la « reproduction de classe » existe depuis l’invention de l’injustice. Et c’est cette loi fondamentale du capital qui a fait que, même criminel pendant l’occupation, le bien-né retrouvait vite sa splendeur après un petit moment d’ombre. L’anecdote que je retiens dans « Industriels et Banquiers » se rapporte à Pierre Taittinger, patriarche d’une dynastie qui, aujourd’hui garde toutes ses plumes. Taittinger, fondateur de la maison de champagne, président du Conseil de Paris nommé par Pétain, est un homme dont le butin n’est jamais assez lourd. Par la copie d’une lettre, Annie Lacroix- Riz nous montre ce Taittinger, le 3 février 1944, écrivant à son ami Lucien Boué, directeur général de « l’aryanisation des biens juifs ». De la lourdeur de sa plume, ce Taittinger s’en vient pousser les feux sous la fortune de son beau-frère Louis Burnouf. Il tance l’immonde Boué qui, dans l’administration des « biens juifs », n’a pas été assez généreux avec le beauf : « Ce qui lui a été réservé jusqu’ici constitue un ensemble de broutilles, plutôt qu’en occupation sérieuse ». Résumons en 1944, après de multiples demandes du même genre, ce Taittinger, lui-même ou par le biais d’amis, règne sur un vaste ensemble de biens volés aux juifs. Et que croyez-vous qu’il arriva, quand De Gaulle et la IIe DB parvinrent à Paris ? Pas grand-chose. Taittinger, l’admirateur de l’entreprise nazie va passer six mois au placard, être déchu de ses droits civiques et inéligible pendant 5 ans. Champagne !
Ici j’en arrive au nouveau bouquin de Lacroix-Riz : « La Non Epuration » toujours chez le courageux éditeur Armand Colin L’anecdote Taittinger est un bon miroir de l’ouvrage. La descendance Taittinger est toujours aux manettes du capitalisme, aux carrefours du pouvoir, à Sciences-Po par exemple. En 1978, dans un entretien donné à Philippe Ganier-Raymond, Darquier de Pellepoix, le Commissaire aux Affaire Juives, héros non épuré, a déclaré : « Á Auschwitz on n‘a gazé que des poux ». On pourrait paraphraser cette ordure d’hier, cette vieille ordure, et écrire avec les mots du Nouveau Monde : « Á la Libération on n’a épuré que des sans-nom, des gens-qui-n’existaient-pas » et pas grand monde au sein des deux cents familles. L’argument qui veut que le Général ait lui-même prêché pour une épuration épargnant les « d’élites » afin qu’elles structurent l’administration de la République, ne tient pas le coup. La prescription de De Gaulle est marginale. L’épuration n’a pas eu lieu parce que les hommes chargés de juger les collaborateurs étaient leurs cousins, leurs amis de lycée, leurs compagnons de conseils d’administration ou de Cour au tribunal. Des deux côtés de la barre, à quelques égarés près, se trouvaient les mêmes familles, en puzzle. Pas question de se bannir dans l’entre soi alors que les communistes, sortis des maquis avec leurs pistolets-mitrailleurs, étaient prêts, disait-on, à prendre le pouvoir. On retrouvait la consigne d’avant-guerre qui voulait qu’Hitler était préférable au Front Populaire, cette nous avions : « Mieux vaut les bulles de Taittinger que le rouge du PCF ».
Á la Libération si les hommes des maquis ont bien exercé cette forme de justice lapidaire, commencée durant la guérilla de la Résistance, elle fut faible. Le livre la décrit et la rétablit dans son rôle historique. Et opère une démystification salutaire puisque perdure l’idée fausse d’une épuration accomplie comme une « boucherie communiste ». Alors que les FTP, dans l’urgence du coup de commando, n’ont épuré que les traîtres les plus visibles, et accessibles. Vite désarmés en 1944, expédiés sur le champ de bataille en Allemagne, les héros des maquis ont été contraints de céder le nettoyage de la France vert de gris à des gens plus raisonnables qu’eux. L’épuration née dans le maquis a vite cédé la main à des magistrats professionnels, dont Annie Lacroix-Riz dresse un tableau qui donne la nausée. Rappelons-nous qu’en 1940 le juge Paul Didier fut le seul à refuser de prêter le « Serment de fidélité à Pétain ». C’est dire si les épurateurs relevaient, eux-mêmes, des sanctions qu’ils étaient en charge d’appliquer.
Au fil du temps cette épuration en caoutchouc mou a tourné à la mascarade. Pour Annie Lacroix-Riz, se plaindre de cette épuration fantôme n’est pas en appeler aux balles des pelotons, au fil de la guillotine. Une véritable épuration économique aurait été la mesure la plus juste et utile pour le pays. En commençant par la nationalisation de tous les biens, de toutes les fortunes des collaborateurs, parallèlement reclus pour une peine plus ou moins longue. Rien de tout ceci n’a eu lieu et la nationalisation de Renault est un petit arbre masquant l’Amazonie.
Très vite, les réseaux du pouvoir d’avant-guerre, non éradiqués, reprenant force et vigueur, se mettent en marche pour sauver la peau des amis collabos. L’urgence est de gagner du temps : chaque jour les tribunaux montrent une indulgence plus grande que la veille. Jusqu’en 1950, où ces crimes devenus lassants, rengaines, ont été étouffés sous les oreillers de l’histoire. En Corée les communistes montrent qu’ils veulent conquérir le monde. Le temps n’est plus à se chamailler pour des broutilles. Aujourd’hui d’ailleurs, l’Europe vient de nous dire que le communisme et le nazisme sont deux blancs bonnets. Et les épurés de 44-50 font, soixante-dix ans plus tard, figures de victimes ou de sacrés cons.
Le diabolique René Bousquet, l’ami de François Mitterrand, le responsable de la rafle du « Vel’ d’hiv », illustre aussi cette « Non Epuration ». En 1949 il est l’avant dernier français à être traduit en Haute Cour. Une juridiction devenue mondaine, où ne manquent que le porto et les petits fours. Bousquet est jugé pour avoir été présent à Marseille lors du dynamitage du Vieux Port par les nazis. Il est acquitté, juste convaincu « d’indignité nationale » et immédiatement relevé de sa sanction pour « avoir participé de façon active et soutenue à la résistance contre l’occupant ». Pas décoré, le Bousquet, mais le cœur y est. Bousquet va rejoindre la Banque de l’Indochine, financer les activités politiques de Mitterrand, parader à l’administration du journal de Toulouse La Dépêche du midi, et siéger au conseil d’UTA compagnie aérienne présidée par Antoine Veil, le mari de Simone.
Ce fiasco, celui de l’épuration, était programmé puisque le livre de l’historienne nous rapporte que dès l’établissement de son Etat-strapontin à Alger, la France Libre n’a jamais souhaité une purge massive de l’appareil économique, politique et militaire de Vichy. Annie Lacroix-Riz montre aussi que, si des « Commissions d’épuration » furent mises en place, ainsi que cela avait été prévu dès le début de l’occupation au sein de la Résistance, elles furent aussitôt réduites à l’impuissance. Le livre, bien sûr, n’oublie pas d’épingler ces collaborateurs devenus résistants par magie, juste à la vingt-cinquième heure. L’un avait « sauvé un juif », l’autre créé un réseau de résistance dont, hélas, personne n’avait entendu parler. Ainsi pour en revenir au destin exemplaire du sieur Taittinger, lors de l’instruction de son procès, il s’en sort en faisant croire que c’est lui qui a convaincu Otto Abetz de ne pas faire sauter tous les monuments de Paris... En la matière, le laborieux parcours de Mitterrand résistant donne un bel éclairage. La légende d’un Tonton résistant n’est entrée dans les esprits, de force, qu’après que le héros a été élu président. Avec le tapage des affidés, la caution de l’ambigu Frenay et le quitus de l’ami Pierre Péan. La journaliste Georgette Elgey, sur le passé de Mitterrand, veillant à la pureté des archives. Un statut de résistant, c’est aussi du marbre, et ça se sculpte aussi.
Le danger de l’épuration écarté, De Gaulle parti à Colombey, les puissants d’avant-guerre, les fans d’Hitler, se montrent plus à l’aise. Deviennent si puissants que le philosophe et résistant Vladimir Jankélévitch, prévoit qu’il est possible que « demain la Résistance devra se justifier pour avoir résisté ». Inquiétez-vous, nous avançons sur cette trace. Au risque de radoter le texte du Parlement européen qui renvoie dos à dos communisme et nazisme nous rapproche de la prédiction de Jankélévitch. Viendra le jour où les martyrs de Chateaubriant devront être extraits de leur mausolée. Dans un tir d’artillerie préparatoire, un révisionniste nommé Berlière et l’odieux Onfray ont déjà entamé une séance de crachats sur la mémoire de Guy Môquet.
La charge des mots est comme celle des canons des fusils, elle fait peur. Images de femmes tondues, de jeunes gens collés au poteau : pour un amateur d’histoire, même de bonne foi, l’épuration est donc décrite comme « sauvage ». Annie Lacroix-Riz démontre que tout cela est un mythe, et rapporte archives en main, que cela n’a jamais eu lieu, et que des femmes furent tondues pour des faits bien plus graves que celui d’avoir partagé le sommier des Allemands.
D’ailleurs, nous disent les historiens bénis au saint chrême du libéralisme, pourquoi « épurer » puisque la France ne fut pas vraiment collaborationniste. Un minimaliste affirmant sans crainte que seuls agirent en France de 1500 à 2000 « collaborateurs de sang ». Finalement c’est peu pour aider les Allemands à provoquer près de 150 000 morts. Puisqu’en mai 1947 « les pertes humaines » s’élevaient à 30 000 fusillés, 150 000 déportés « morts ou disparus », de 95 000 « déportés politiques » et de 100 000 « déportés raciaux ». Cruelle mathématique qui nous démontre que l’historien qui minore nombre des criminels devrait réviser son Histoire.
Assigner le rôle de la Résistance à l’action d’une troupe de vengeurs, sortis de maquis qui n’existaient pas, ou peu, pour dresser des poteaux d’exécution le jour de la Libération, et manier la tondeuse, est une sale besogne. Pourtant entreprise par quelques historiens sponsorisés qui parlent à la télé. Ces « chercheurs » sont fidèles à leur obsession : l’effacement du CNR, des FTP, de la France-Libre. Pour réécrire l’Histoire et nous convaincre que si nous sommes aujourd’hui libres, nous ne le devons pas à Stalingrad mais exclusivement à l’ami Américain.
Ici relevons une contradiction sortie de boites d’archives qui sont bien entêtées. Si la Résistance n’était rien que du pipi de chat, pourquoi, pendant l’occupation, Londres et Washington se sont-ils ligués pour annihiler la France Libre et De Gaulle ? Pourquoi un complot contre Jean Moulin ? Pourquoi ? Si ses hommes et leurs troupes sont négligeables ? Soudain dans « La Non Epuration » apparaît, sans tapage et avec modestie, un chapitre pourtant considérable. Justement il traite de la trahison faite à Jean Moulin. Des pages passionnantes, haletantes, un peu sacrées. Le travail d’Annie Lacroix-Riz permet enfin de clouer la porte aux fantasmagories envahissantes : René Hardy, l’anticommuniste maladif, a bien vendu Moulin. Mais pourquoi, pour qui ? Pour le compte d’une phalange d’extrême-droite. Un groupe cagoulard, c’est-à-dire à ses industriels et ses banquiers, soucieux d’éviter à la France de demain les dangers d’un régime trop rouge. Celui que Moulin et les FTP auraient pu soutenir.
Vous l’avez compris, une historienne qui écrit la vérité sur tous nos Taittinger, nos Renault, nos Wendel et autre homo-copies doit être karcherisée. La voyez- vous parler de ses recherches dans des médias dont quelques-uns sont encore entre les mains de fils et de filles dont les parents ont eu de la chance entre 40 et 45 ?
Son travail me fait penser à celui de la chercheuse britannique Frances Stonor Saunders. Qui a publié une étude inoxydable et jubilatoire sur le rôle de la CIA comme machine à soutenir, guider, aider, financer des milliers d’artistes et intellectuels européens et américains, avant et après la Seconde guerre. Investissement fou dont le but était de contrer les dangers « de la création soviétique ». Traduit en France et publié par Denoël en 2004, ce livre, Qui mène la danse, est aujourd’hui introuvable. Si rare qu’il coûte plus de 600 euros, d’occasion sur Internet. Pour une fois permettez moi de vous donner un conseil qui sort de mon champ, celui d’un boursier : achetez « La Non Epuration ». Si la politique totalitaire, maintenant en marche, progresse un peu, le bouquin d’Annie Lacroix-Riz se vendra sous le manteau. Et vous le revendrez alors très cher.
Jacques-Marie BOURGET
La « Non Epuration » éditions Armand Colin.